Premier extrait de mon premier livre ‘’ la Gueule de l’hiver’’ : Takfa la louchonne : En hommage à Khalti Zineb de M.Chahlal Mohammed

Premier extrait de mon premier livre ‘’ la Gueule de l’hiver’’ : Takfa la louchonne
En hommage à Khalti Zineb de M.Chahlal Mohammed
Zaid Tayeb

L’une de ces nombreuses femmes paysannes sur qui le destin s’était plus particulièrement acharné, une petite vieille qui ne s’était jamais mariée, et que les gens du village, grands et petits, appelaient Takfa la Louchonne, n’avait rien au monde et le monde n’avait dans son répertoire rien de semblable à Takfa la Louchonne que Takfa la Louchonne. Tout le monde avait un toit en dur, une famille, quelques bêtes. Takfa n’avait que deux choses : une petite tente en alfa constellée de trous ronds et une vieille ânesse noire et maigre. Deux vieilles bêtes, l’une humaine, l’autre animale. On voyait rarement la Louchonne chez elle, et souvent sur son ânesse. Quand le vent soufflait à emporter la petite tente comme une coquille vide sur une plage par un jour de grande tempête, quand le tonnerre martelait le ciel à crever les tympans avec son lourd maillet, quand l’éclair le lacérait de son fouet de feu, Takfa adressa une seule prière à Dieu, et Dieu n’avait jamais renvoyé la prière de Takfa la Louchonne à un autre jour : ‘’Dieu, Faites que cet orage soit sans eau’’. Cette prière lui attirait le courroux des paysans qui vivaient de l’eau de pluie, eux, leurs bêtes et leurs récoltes. La sécheresse était leur ennemi le plus cruel et le plus implacable. De temps en temps, une prière rogatoire présidée par le fkih et ses disciples pour appeler la pluie sur leurs terres arides et desséchées que le soleil avait en partie grillées s’avérait nécessaire mais souvent vaine. Tout le monde participait à cette prière inaccoutumée contrairement aux cinq prières quotidiennes où la petite mosquée du village restait le plus souvent vide de ses fidèles. Mais la Louchonne n’avait ni bêtes ni récoltes et sa petite prière était mieux entendue que celle de tous les paysans assemblés avec à leur tête leur fkih. Elle n’avait que sa petite tente qui était aussi fragile qu’elle et que le moindre souffle menaçait d’arracher avec les piquets qui la fixaient au sol. Elle ne retenait ni les ardents rayons du soleil de juillet, ni les glaciales gouttes de pluie de janvier, ni les rafales répétées des tempêtes soudaines et imprévisibles de l’automne. Seulement, dans sa petite tente, Takfa se sentait chez elle. Elle avait son chez elle, contrairement aux bêtes ! Chacun donc faisait ses prières en fonction de ses craintes et de ses besoins. Takfa avait des craintes, les paysans des besoins. Et les prières pour détourner des craintes eurent le dessus sur les prières pour concrétiser des besoins. En un mot, les paysans ne l’aimaient pas. A les en croire, ses prières contrariaient la pluie et que, comme elle n’avait pas de mari, elle devait entretenir des relations secrètes avec le diable grâce à des actes de sorcelleries qu’elle accomplissait dans le noir sous cette satanée tente qui avait résisté à toutes les tempêtes. Elle leur inspirait également une crainte qu’ils n’osaient pas exprimer. Une espèce de resserrement au cœur et à la gorge les mettaient mal à l’aise quand ils la croisaient ou quand ils passaient devant chez elle. Takfa, quant à elle, elle n’en voulait nullement à ses voisins de ne lui avoir pas construit une petite maison en dur dans un environnement où la matière première et la main d’œuvre ne manquaient pas. Elle aurait bien aimé être considérée comme une personne humaine pour mériter un peu d’attention et d’égards de la part de ses voisins. Mais il n’en fut rien. Elle resta à l’écart sous sa petite tente. Certaines paysannes refusaient, elles aussi, de se mêler à cette vieille femme restée célibataire. Pour elles, elle devrait avoir un époux, comme elles. Elles avaient peur, en quelque sorte, qu’elle leur ravisse leur mari. Quand elles la plaisantaient pendant les réunions féminines, elle leur répondit que le mari qu’elle voulait épouser n’était pas encore né. Les femmes lui répliquèrent alors qu’elle pouvait toujours espérer, qu’elle avait les reins solides et que tôt ou tard, un homme se présenterait pour lui demander sa main. A cette remarque, elle leur montra ses dents noires et une méchante bague qu’elle portait à l’annulaire de la main gauche couverte de dessins compliqués tracés au henné. Les femmes n’arrêtaient pas de la taquiner. Elles voulaient savoir comment une femme pouvait dormir toute seule dans un lit et sous une tente alors que le village grouillait de jeunes étalons aussi forts que des buffles. Elles lui avouaient qu’elles la voyaient souvent hors de chez elle. Serait-elle tombée, sans le leur avouer, sur l’homme de ses rêves, un quelconque berger qu’elle allait voir derrière la colline, sous prétexte d’aller ramasser du bois sec ? Les fagots de bois qu’elle avait ramenés de ses nombreuses sorties n’avaient pas diminué de volume et elle était peu dépensière en bois de chauffage ! Se pouvait-il qu’elle ait un fiancé ou un mari qu’elle leur cachait ? Elle aurait sans doute été déjà mariée quelque part avec un homme qui l’aurait abandonnée pour s’en aller avec une autre ! Ah ! Qui pouvait se fier aux hommes ? Ce n’était pas possible, après tout, qu’elle ne se soit jamais mariée ! A tout cela, Takfa riait de ses dents noires et de ses yeux blancs. Elles restèrent un bon moment à la plaisanter, à essayer de lui soutirer quelques confidences libertines enfouies dans ce vieux cœur insondé de cette vieille fille sans mari. Elles n’en tirèrent rien. Il se pourrait également qu’elle n’ait rien à leur confier. Elle était gaie et souriante malgré les nombreuses plaisanteries, le plus souvent méchantes et désobligeantes à son égard.
Les femmes voyaient rarement Takfa sans son ânesse. Elle leur confia sur le ton le plus certifié et de la voix la plus sincère qu’elle était sa meilleure compagne, qu’il lui arrivait souvent de lui parler comme à une personne, qu’elle savait si bien garder le secret et qu’elle ne se plaignait jamais ni de la faim ni de la soif ni des intempéries tellement elle était sobre en tout. Elle leur racontait maintes histoires qui lui étaient arrivées à elle, Takfa, et que les gens ne pouvaient pas comprendre tellement ils étaient aveugles et sourds aux mystères de la vie qui peuplent l’univers. Son ânesse l’avait une fois sauvée des mâchoires d’une meute de chiens affamés qu’elle avait assommés à coups de sabots. Elle leur tournait ses flancs, ruant, distribuant des coups à droite et à gauche. Ils finirent par déguerpir en hurlant. Elle avait un autre jour galopé comme une jument à cause des brigands qui s’étaient lancés à ses trousses dans les profondes et inquiétantes gorges de la Gueule de l’Hiver !
-Nous nous y engouffrâmes au galop, sortîmes de l’autre côté en un rien de temps, remontâmes la petite pente et bien vite fûmes en vue du village ! J’avais peine à me maintenir sur son dos tellement ça ballotait ! Elle s’arrêta devant la tente, bavant et couverte d’écumes blanches ! J’étais en bouillie mais saine et sauve, bien loin de ces maquereaux qui voulaient me détrousser ! Je l’avais échappé belle ! Ce soir-là, elle avait droit à un demi-boisseau d’orge ! Elle l’avait bien mérité ! N’est-ce pas ?
Son visage s’éclaira. Ses yeux brillèrent dans sa face de vieille fille que le temps avait soigneusement travaillée par des rides aux coins des yeux et au front. Elle attendait des compliments ou des explications.
-Les brigands n’en voulaient ni à ta bourse ni à ton ânesse ! S’empressa de dire, en clignant de l’œil, l’une des femmes qui formaient cercle autour de Takfa.
-C’est après toi, Takfa, qu’ils en voulaient, ces hommes ! Ils savaient bien que tu avais encore quelque chose de bon à leur offrir et que tu conservais jalousement, malgré ton âge ! Ce n’est pas comme nous autres qui avons chacune une nichée de marmots ! Nous n’avons plus rien de bon à donner aux hommes !
-Qui serait assez fou pour daigner jeter un coup d’œil sur des loques comme nous ? dit une autre avec une petite moue sur les lèvres. Elle appuya plus sur les mots à connotation malsaine.
-Tu en as de la chance, Takfa, que les hommes te regardent avec des yeux pleins de feu et de flammes, déclara la première en regardant les femmes présentes pour rechercher dans leur regard un signe d’approbation ou de complicité.
Et toutes les femmes éclatèrent d’un rire bruyant. Elles se mirent à parler toutes ensemble. Elles se pinçaient les cuisses ou se mordillaient les lèvres pour se transmettre leurs espiègleries. Cependant Takfa avait l’habitude de ces choses-là. Elle savait si bien encaisser les propos les plus farfelus de ces femmes qui se payaient sa tête. Elle leur laissa suffisamment de temps pour babiller entre elles. Elle resta silencieuse à les regarder pouffer de rire tout en s’essuyant les yeux, de temps à autre, dans le bas de leur robe. Elles connaissaient Takfa depuis qu’elles étaient toutes jeunes mais elles trouvaient spirituel que les hommes lui couraient derrière. Takfa était indifférente à ce que ces bonnes femmes disaient. Elle ne les interrompait pas, ne les démentait pas non plus, ne se mettait jamais en colère contre elles. Elle les écoutait rire aux éclats, dévoilant leurs gorges blanches, se donnant des tapes sur les épaules ou sur les cuisses. Elle les considérait une à une attendant qu’elles arrêtent leur manège pour reprendre son récit. Certaines recherchaient dans les paroles et gestes de Takfa un brin de débilité ou de crétinisme. Elles ne découvrirent chez cette femme sans mari qu’un cœur débordant de simplicité et de naturel.
-Mais le souvenir qui m’a le plus marquée, enchaîna-t-elle, et que je garde jalousement dans ma poitrine comme une chose à laquelle on tient beaucoup et qu’on a peur de perdre ou d’oublier, est celui de cette nuit d’hiver, de pluie et de vent. Alors que je dormais comme une bête, mon ânesse brayait à se rompre le cou, tirait sur la corde qui la tenait attachée au piquet, donnait des coups de sabot sur le sol, soufflait de ses naseaux noirs pour donner l’éveil. Et moi, comme une sotte, je dormais, enveloppée sous mes couvertures, de la tête aux pieds, bien au chaud, pendant qu’elle assurait la garde sous la pluie et le vent ! Quand enfin je me réveillai et mis la tête au dehors, dans l’obscurité et le froid, je vis des silhouettes humaines aller en direction du village. Elles me tournaient le dos. Je les vis s’éloigner sans précipitation. Après tout, ce n’est pas une pauvre et vieille femme comme moi qui les inquièterait. Je me remis au lit avec la sombre idée qu’ils reviendraient pour m’égorger. Le matin, je fis le tour de la tente et découvris qu’il y avait moins de bois dans l’enclos. Heureusement pour moi. On aurait pu me tuer ! Sans mon ânesse, à l’heure qu’il est, je serais morte et enterrée.
Les femmes, ébahies, l’écoutaient leur raconter ses petites misères. Elles s’estimaient heureuses d’avoir des maris. Qui oserait rôder devant une maison où il y a un homme ? Pauvre femme ! Si seulement elle avait une maison en dur avec une porte qui ferme à clé ! Ainsi au moins elle pouvait s’enfermer chez elle et se sentir en sécurité. Elles la plaignaient du fond de leurs cœurs attendris, elles qui, il y avait un moment, se payaient sa tête ! Elles devinrent sombres, pensives. Elles avaient honte d’elles-mêmes de s’être conduites comme des gamines avec une pauvre femme aux sentiments si nobles. Elles l’avaient souvent raillée, la pauvre !
Takfa débitait ses récits par ‘’un jour, mon ânesse’’ et les terminait par ‘’ oui, mes sœurs, les bêtes, c’est comme les humains ! Seulement, elles ne parlent pas !’’. Les femmes, graves et attentives, écoutaient les récits de Takfa avec beaucoup d’intérêt et d’appréhension. Il y avait beaucoup de mystère dans ce qu’elle disait. Il leur était difficile de ne pas croire les récits de cette vieille fille à la vie ténébreuse et qui mettait toute sa bonne foi pour leur narrer des histoires qui lui ressemblaient.
Quand elle manquait de bois pour son âtre par les froides nuits d’hiver, elle s’en alla le chercher sur les collines voisines. On la vit quitter sa tente et son ânesse et ne revenir chez elle que tard dans la soirée. Elle portait sur son dos voûté à craquer un lourd et volumineux fagot de bois. Elle avançait, les yeux rivés sur le mince sentier dont elle suivait du regard les sinuosités, le menton aux genoux, la cordelette autour des poignets lacérés. Quand elle n’en pouvait plus, à cause de l’âge, du poids et du volume de son fardeau, elle choisit une roche sur laquelle elle reposa son derrière sans jamais lâcher la cordelette qui lui coupait les poignets, puis, au bout d’un moment, quand elle eut soufflé, et repris un peu de ce qui lui restait de force dans ce corps de femme sans mari rongé par la misère, elle se releva lentement, péniblement tout en se courbant au maximum afin de maintenir le fagot en équilibre. Elle appela à elle tous les saints de la petite commune d’Ilma, juchés sur les collines, dans la blancheur de leurs coupoles. Les premiers pas après une pause, fût-elle brève, étaient les plus pénibles pour cette vieille fille. Elle fut d’abord déséquilibrée et emportée par la lourde charge qui ballotait à gauche et à droite. Elle se redressa pour le remettre bien en place sur son dos arqué. Elle avança par petits pas le long de la descente. Arrivée devant sa tente, elle se libéra de la cordelette et le fagot tomba par terre en soulevant un nuage de poussière. Elle avait la main en sang. Elle ne la sentait plus tellement la corde la lui avait sciée. Elle arrangea les branches et les brindilles en croissant de lune afin de permettre à sa bête de profiter d’un espace bien aménagé contre le souffle du vent. Puis, elle rentra sous sa tente, alluma un feu et se fit un café qu’elle dégusta avec un quartier de pain qu’elle prit soin de chauffer sur les braises. D’ailleurs, ce fut le seul aliment qu’elle préparait chez elle. De temps en temps, elle avança vers le feu sa main blessée. Elle l’ouvrit et la referma, la frotta contre l’autre, la regarda de près, souffla dessus avec sa bouche à moitié édentée et ses lèvres fendues.
Zaid Tayeb : La Gueule de l’hiver. Roman. Edilivre. France
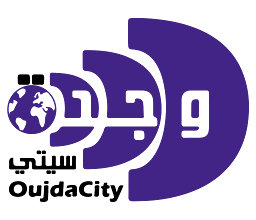

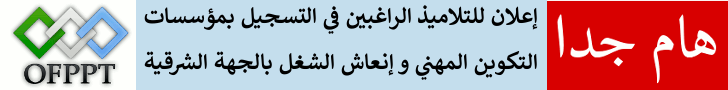



Aucun commentaire